Le courant dominant de la vie politique en Europe et en Amérique du Nord se voit de plus en plus divisé en deux camps opposés : d’un côté les conservateurs et réactionnaires glorifiant l’impérialisme et souhaitant le ressusciter, et de l’autre ceux qui se prétendent progressistes, libéraux et socialistes, exprimant à des degrés divers une honte
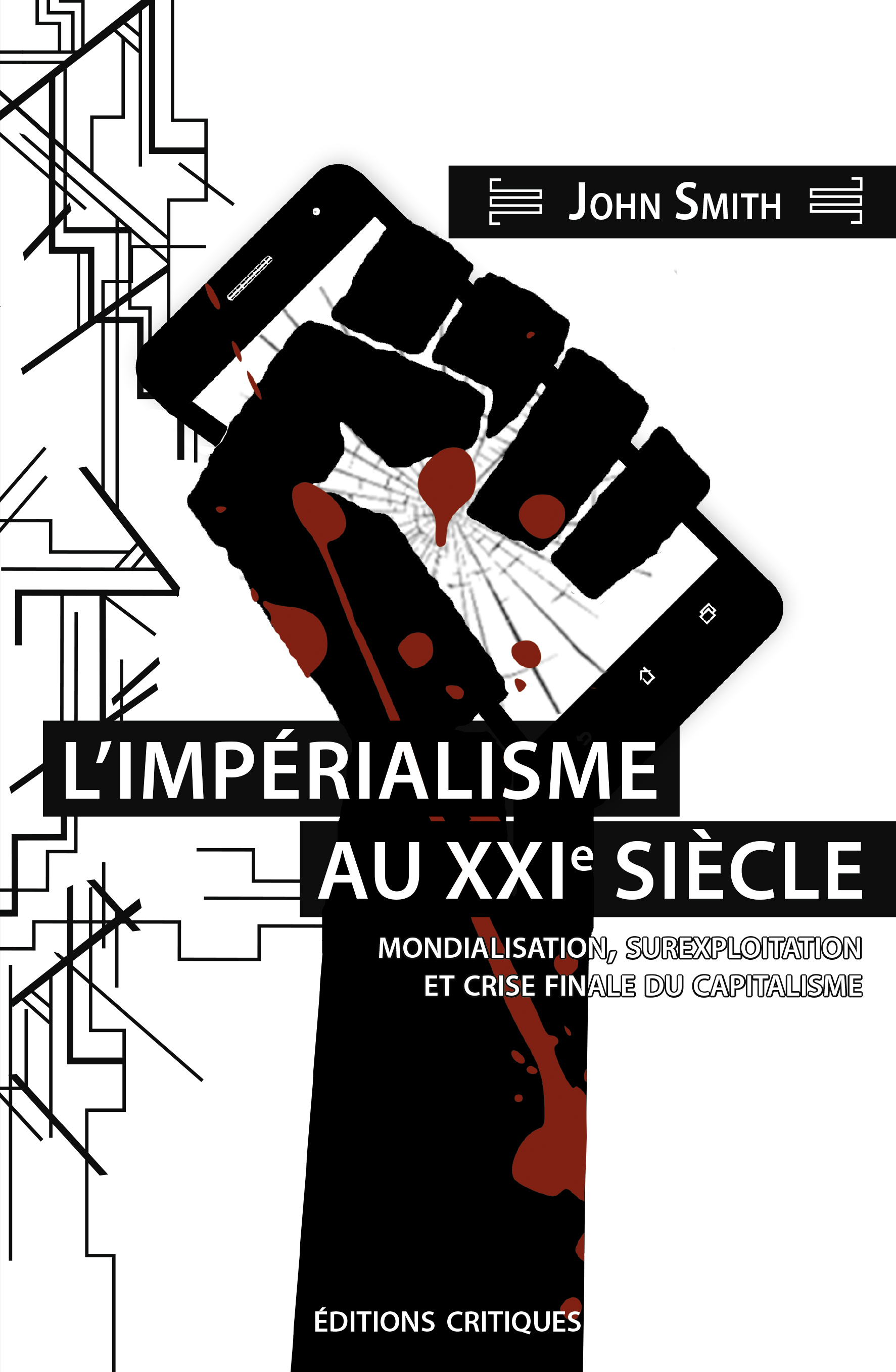
à l’égard du passé mais nient que l’impérialisme soit toujours un élément significatif pouvant servir à définir les relations entre pays riches et pauvres. Même le débat au sujet des réparations des crimes de l’esclavage et de la colonisation est défini en termes de corrections d’erreurs passées, excluant toute idée que le pillage impérialiste de la nature et du travail vivant puisse se poursuivre allègrement au sein du monde moderne « postcolonial ».
L’une des raisons de cet aveuglement est la confusion des notions d’impérialisme et de conquête coloniale : à l’exception de l’Irlande du Nord et de la Palestine occupée, les colonies appartiennent au passé, et par conséquent l’impérialisme aussi. Mais la domination coloniale n’est qu’une des formes possibles de l’impérialisme ; son essence immuable est le pillage des richesses humaines et naturelles. Le capitalisme a engendré des moyens de pillages nouveaux et bien plus efficaces que l’envoi de troupes saccageant les pays pauvres et massacrant leurs populations. De même que l’esclavage comme possession d’être humain fut remplacé par la silencieuse contrainte de l’esclavage du salariat, par lequel les travailleurs vendent « librement » leur force de travail aux capitalistes, de même le pillage colonial a été remplacé par ce que l’on connaît sous l’euphémisme de « libre-échange ».
Les coûts du café
Considérons, par exemple, une tasse de café de 3,00 € achetée dans une enseigne d’une grande chaîne. Seulement 1 centime va au fermier qui cultive et récolte le café. Au cours de ces dernières années, le prix sur le marché mondial pour les fèves vertes de café a chuté à 2,40 € le kilogramme s’approchant ainsi de son niveau historique le plus bas en termes réels. Pour la plupart des 25 millions de petits fermiers qui cultivent 94 % du café mondial, ce chiffre est bien inférieur au coût de production. Les cultivateurs de café en Amérique centrale, par exemple, ont besoin de 3,96 à 4,92 € par kilogramme uniquement pour atteindre leur seuil de rentabilité. Ainsi, à l’heure actuelle, ils n’obtiennent absolument rien de leur dur travail et de celui de leurs enfants, qui ordinairement aident à la récolte. En revanche, ils croulent sous les dettes, voient leurs enfants mourir de faim, certains se tournent alors vers la culture de la coca, de l’opium ou de la marijuana, beaucoup abandonnent leurs fermes et partent en direction de la frontière des États-Unis ou bien des vastes bidonvilles ceinturant des villes submergées.
Pendant ce temps-là, les firmes capitalistes qui torréfient le café, presque toutes basées en Europe et en Amérique du Nord, voient leurs profits grossir encore, tandis que les chaînes vendant les tasses de café et les propriétaires de leurs locaux récupèrent à peu près la moitié du prix de cette tasse en profit.
L’illusion du PIB
Fait remarquable, sur les 3,00 € de la tasse de café vendue au Royaume-Uni, tout sauf 2 centimes sont comptabilisés dans le PIB de ce pays. C’est là une illustration particulièrement flagrante de l’illusion de PIB, l’incroyable tour de passe-passe grâce auquel la richesse générée par les agriculteurs et travailleurs surexploités dans les plantations, les mines et les ateliers de misères à travers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine réapparaît comme par magie dans le produit « intérieur » brut des pays où les produits de leur travail sont consommés. Et ils sont surexploités car, peu importe  qu’ils travaillent dur, ils ne peuvent pas nourrir leurs familles ou subvenir à leurs besoins essentiels tels que l’éducation ou la santé que les travailleurs des pays riches considèrent comme des droits imprescriptibles.
qu’ils travaillent dur, ils ne peuvent pas nourrir leurs familles ou subvenir à leurs besoins essentiels tels que l’éducation ou la santé que les travailleurs des pays riches considèrent comme des droits imprescriptibles.
Ce qui est vrai pour le café l’est aussi, à des degrés divers, pour nos vêtements, gadgets, ustensiles de cuisine et bien d’autres choses. Par exemple, sur les 22 € payés à Primark ou Marks & Spencer pour une chemise fabriquée au Bangladesh, au maximum 1,1 € apparaîtra dans le PIB du Bangladesh, dont peut-être 1 centime sera verser à l’ouvrière de l’habillement à qui 70 heures de travail hebdomadaire ne suffisent pas à nourrir ses enfants. Si l’on fait abstraction du coût de la matière première, le coton, la plus grande part de ces 22 € vont apparaître dans le PIB du pays où ce produit est acheté pour la consommation.
Environ 40 % du prix de vente final finira entre les mains du gouvernement — pas seulement les 20 % de TVA, mais aussi les impôts sur les bénéfices du magasin, ceux du propriétaire des murs, et des autres fournisseurs de services, ainsi que sur les salaires de tous ceux qui travaillent pour eux. Le gouvernement utilise alors cet argent pour payer l’armée et la police, le système de santé, les retraites, etc. Ainsi, quand quelqu’un demande : « Pourquoi devrions-nous laisser les migrants utiliser notre système de santé ? », on devrait leur répondre : « parce qu’ils ont contribué à le financer ! » Malheureusement, personne à « gauche » ne dit actuellement cela !
L’impérialisme du XXIe siècle
Au cours de ce que nous appelons l’ère néolibérale, depuis les années 1980 environ, les capitalistes ont transféré la production de vêtements et de beaucoup d’autres objets dans des pays à bas salaires. Leur motivation : augmenter les profits en substituant du travail peu rémunéré à l’étranger au travail domestique trop cher, taillant ainsi dans la masse salariale tout en évitant une confrontation directe avec leurs ouvriers. Une grande partie de ce que nous avions l’habitude d’appeler le « Tiers-monde » est alors devenue une gigantesque zone franche d’exportation produisant des intrants et des biens de consommation bon marché pour l’Europe et l’Amérique du Nord. En conséquence de quoi, les profits, la prospérité et la paix sociale au sein des pays riches sont devenus de plus en plus dépendants de la surexploitation de centaines de millions de travailleurs dans les pays pauvres. Ceci doit être appelé par son vrai nom : l’impérialisme ; une forme nouvelle et moderne d’impérialisme capitaliste, laquelle ne s’appuie pas sur les techniques grossières héritées de l’époque féodale — mais qui pratique à coup sûr le terrorisme d’État, la guerre secrète, et l’intervention militaire directe chaque fois que cela s’avère nécessaire.
Le transfert mondial de la production a non seulement permis une restauration de la rentabilité et un redémarrage de l’accumulation du capital, mais il a aussi considérablement accru la concurrence entre travailleurs au-delà des frontières. Dans la lutte économique — la lutte visant à protéger et améliorer sa position au sein du système capitaliste contrairement à la lutte politique visant à l’abolir — chercher à se protéger contre une concurrence
accrue est un réflexe naturel et normal. Mais cela ne le rend pas progressiste ! Le revers de la médaille de l’émigration de la production en direction des pays à bas salaires est l’immigration des travailleurs depuis ces pays. L’hostilité à l’égard de l’immigration a été le facteur le plus important qui a incité la plupart des travailleurs britanniques à voter contre l’adhésion à l’Union européenne. Le réflexe des travailleurs en réaction à une concurrence accrue — appelant à construire des murs et fermer les frontières — est le meilleur exemple que l’on puisse trouver pour illustrer ce que Lénine appelait « cette tendance spontanée qu’à le trade-unionisme [le syndicalisme] à se réfugier sous l’aile de la bourgeoisie » (1).
Les preuves de la persistance, et même de l’omniprésence, de l’impérialisme sont tout autour de nous. Pourtant, les libéraux, les sociaux-démocrates et même beaucoup de ceux qui se considèrent comme révolutionnaires restent aveugles, aidés en cela par un pinaillage sémantique à propos de ce qu’« impérialisme » signifie, se cachant derrière des statistiques qui obscurcissent la question plus qu’elles ne l’éclairent. L’impérialisme glorifié est détestable, mais l’impérialisme nié est un obstacle bien plus important à la construction d’un mouvement capable de renverser la dictature des riches cachée derrière la façade en piteuse état et discréditée de la démocratie.
(1) Lénine, Que faire ?, dans Œuvres choisies, vol. 1, Moscou, Éditions du progrès, 1968, p. 142.
John Smith est chercheur indépendant et militant, auteur de L’Impérialisme au XXIe siècle. Mondialisation, surexploitation et crise finale du capitalisme, Éditions Critiques, Septembre 2019. (Édition originale : Monthly Review Press, 2016. L’ouvrage de John Smith est le premier lauréat du Prix Paul Baran-Paul Sweezy).
 Henry BERNSTEIN, sociologue, professeur à la SOAS de l’University of London, présentera son livre « L’agriculture à l’ère de la mondialisation » le mardi 22 octobre à la Sorbonne à 17H30
Henry BERNSTEIN, sociologue, professeur à la SOAS de l’University of London, présentera son livre « L’agriculture à l’ère de la mondialisation » le mardi 22 octobre à la Sorbonne à 17H30
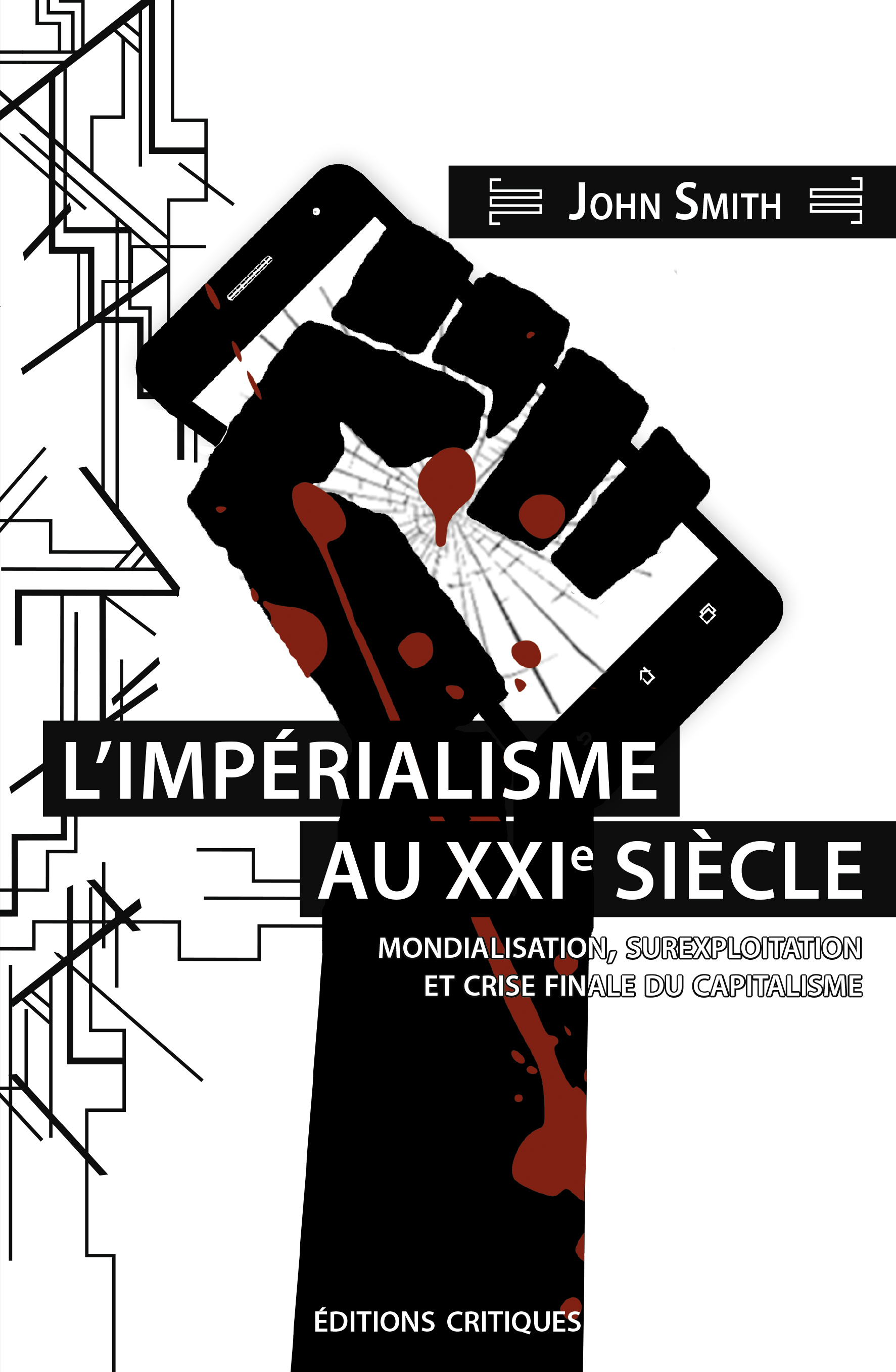
 qu’ils travaillent dur, ils ne peuvent pas nourrir leurs familles ou subvenir à leurs besoins essentiels tels que l’éducation ou la santé que les travailleurs des pays riches considèrent comme des droits imprescriptibles.
qu’ils travaillent dur, ils ne peuvent pas nourrir leurs familles ou subvenir à leurs besoins essentiels tels que l’éducation ou la santé que les travailleurs des pays riches considèrent comme des droits imprescriptibles.
 légitimes sur la nature du système politico-économique chinois, Rémy Herrera et Zhimming Long prennent le parti du temps long. Resituant le développement économique récent dans les dynamiques séculaires de ce géant, les auteurs opèrent une véritable chasse aux lieux communs.
légitimes sur la nature du système politico-économique chinois, Rémy Herrera et Zhimming Long prennent le parti du temps long. Resituant le développement économique récent dans les dynamiques séculaires de ce géant, les auteurs opèrent une véritable chasse aux lieux communs.